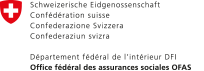Unternavigation
Personnes en situation de handicap
Le handicap a toujours fait partie de l'histoire des sociétés humaines. Pourtant, jusque tard durant le XXe siècle, les personnes privées de ressources en raison d’un handicap dépendaient de l’aide sociale. Il a ainsi fallu attendre la mise en place des assurances sociales, et en particulier de l’assurance-invalidité (AI) en 1960, pour que leur situation s’améliore de façon significative. Toutefois, les assurances sociales réduisent la condition de la personne handicapée à l’incapacité de gain, faisant oublier ses besoins sociaux et culturels. C’est à cette lacune que la politique de l’intégration et de l’égalité, actuellement pratiquée, entend remédier.
De nombreux facteurs déterminent le handicap : les atteintes aux capacités physiques ou intellectuelles, les obstacles à surmonter au quotidien et dans la vie professionnelle, les préjugés sociaux et les chances et ressources dont chacun dispose. En outre, les porteurs de handicap ont des besoins très divers. Enfin, la notion de handicap a évolué au fil des époques.
La condition de la personne handicapée avant la sécurité sociale
Durant des siècles, le handicap était le lot quotidien d’un grand nombre d’hommes et de femmes. Faute de soins médicaux et d’une alimentation adéquate, les naissances difficiles, les maladies et les accidents graves occasionnaient souvent des séquelles permanentes. L’enfance et la vieillesse étaient des étapes particulièrement dangereuses : les enfants en mauvaise santé ne survivaient en général pas plus de quelques années et le vieillissement naturel commençait plus tôt qu’aujourd’hui. Jusqu’au XIXe siècle, une grande partie des personnes de plus de 30 ans souffraient déjà d’une perte d’acuité visuelle et auditive. En outre, les porteurs de handicaps suscitaient à la fois l’étonnement et le rejet, de sorte que l’attitude face aux personnes difformes ou de petite taille allait, au XIXe siècle encore, de l’effroi à la fascination, comme le prouve l’exhibition de « nains » et de « monstres » sur les terrains de foire. Considérées comme des « caprices de la nature », ces infirmités congénitales étaient l’expression – selon le point de vue de l’observateur – de la diversité de la vie ou de la colère de Dieu.
Les déficiences physiques, en particulier, limitaient considérablement la capacité de travail. La personne qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins et qui n’était pas soutenue par sa famille était condamnée à la pauvreté et recueillie dans des couvents ou des hospices. De nombreuses localités accordaient aux malades et aux infirmes l’autorisation de mendier à titre exceptionnel. Considérés comme des « pauvres honorables », ceux-ci avaient droit à l’assistance publique, contrairement aux pauvres capables de travailler, à qui l’administration refusait systématiquement son aide. Néanmoins, les subsides versés aux personnes handicapées sont restés modestes et dépendants du besoin individuel jusque vers le milieu du XXe siècle.
La croyance en la capacité d’apprentissage de l’individu, qui s’est imposée pendant le Siècle des Lumières, a graduellement modifié l’attitude envers le handicap et donné naissance à la pédagogie curative telle qu’on la connaît actuellement. À ses débuts, cette foi en la guérison par la formation s’est surtout appliquée aux personnes atteintes de handicaps sensoriels et mentaux, de sorte que la Suisse vit fleurir, après 1800, des instituts pour aveugles, sourds-muets et handicapés mentaux. La même époque vit l’avènement de la psychiatrie, dont la mission consistait à guérir les maladies psychiques. Ces nouvelles institutions, dont un grand nombre existe encore, combinaient l’isolement spatial avec des mesures thérapeutiques propres à chaque handicap. Elles enseignaient ainsi le braille aux fillettes et garçons aveugles et le langage articulé – exceptionnellement la langue des signes – aux sourds. Après l’inscription dans la Constitution fédérale de 1874 du principe de scolarité obligatoire, de nombreux cantons et communes créèrent des classes et des écoles spécialisées pour les enfants handicapés ou présentant des difficultés d’apprentissage, auparavant peu scolarisés. Au XXe siècle, l’action de la pédagogie curative et spécialisée allait s’étendre aux enfants et jeunes présentant des troubles du comportement et jugés « difficiles ».
Les progrès de la science au XIXe siècle, en particulier de l’hygiène et de la chirurgie, apportèrent de l’eau au moulin de la vision médicale des écarts (physiques) par rapport à la norme. Ainsi, l’orthopédie se spécialisa dans la correction des membres mal formés en prônant des exercices de gymnastique et des interventions chirurgicales et mit au point des techniques opératoires pour traiter le pied bot et le goitre. Pour les malades chroniques et les personnes handicapées, le développement des soins hospitaliers n’eut en revanche pas que des avantages. Les nouveaux établissements faisaient en effet davantage la différence entre maladies guérissables et infirmités incurables, de sorte que ceux qui souffraient de ces dernières ne bénéficiaient pas des meilleurs soins. S’ils étaient en outre à l’assistance sociale et qu’ils n’avaient pas de famille, ils finissaient souvent à l’hospice. Après 1900, de nombreux établissements de soins et d’assistance spécialisés virent le jour pour les tuberculeux, par exemple.
Au XXe siècle, la question du handicap fit naître d’autres angoisses, suscitées par exemple par les découvertes et les théories de la génétique. Les personnes handicapées furent ainsi cataloguées comme « inférieures » et les malformations et infirmités interprétées comme un signe de dégénérescence de la société. A partir de 1900, les méthodes eugéniques – prônant la « prévention des tares » – allaient gagner du terrain non seulement dans la psychiatrie, mais aussi dans la pédagogie curative. Reposant sur des motifs aussi bien eugéniques que sociopolitiques, les mesures adoptées à cet effet, telles que les interdictions de se marier et les stérilisations, concernaient surtout des personnes (prétendument) atteintes de maladies mentales ou psychiques et, dans une moindre mesure, des sourds et des aveugles. Après 1945, en raison des critiques que soulevèrent les 400 000 stérilisations forcées et l’assassinat de bien plus de 100 000 personnes handicapées dans l’Allemagne nazie, de plus en plus de milieux en Suisse se distancient de l’eugénisme.
Après la Deuxième Guerre mondiale, l’attitude envers les personnes handicapées évolue elle aussi, sous le double coup de l’envol de l’économie et de la libéralisation de la société. L’objectif du soutien individuel gagne en importance, tandis que les arguments économiques en perdent. Depuis les années 1980, l’opinion publique s’intéresse à nouveau à la question de la vulnérabilité et de l’acceptation de la condition de personne handicapée, quoique dans un contexte fondamentalement différent. À cet égard, les progrès de la médecine présentent deux faces différentes : d’une part, on observe une augmentation du nombre de traitements permettant de guérir des infirmités congénitales ou dues à un accident. D’autre part, les femmes et les couples doivent toujours plus souvent trancher la difficile question de l’avortement, étant donné que le diagnostic prénatal permet de détecter davantage de handicaps avant la naissance. A l’autre extrémité de l’existence, l’augmentation de l’espérance de vie a pour corollaire un nombre toujours plus élevé de personnes démentes – fortement gênées dans la réalisation des actes de la vie quotidienne – qui requièrent beaucoup de soins.
La perspective des assurances sociales : le handicap, un fait individuel
Les assurances sociales du XXe siècle ont non seulement couvert le risque du handicap, mais aussi conféré une signification particulière à la condition de personne handicapée. Héritière des assurances ouvrières de Bismarck, la sécurité sociale considérait avant tout les hommes et femmes handicapés sous l’aspect de l’incapacité de gain. L’invalidité – le terme retenu par les assurances sociales – avait ainsi pour conséquence une atteinte à la capacité de gain, qui pouvait être provisoire ou permanente, partielle ou totale. Donnée actuarielle d’une grande importance, le degré d’invalidité se mesurait à la différence de revenu avant et après l’apparition de l’incapacité de gain. En conséquence, l’assurance ne couvrait que la perte de gain et, donc, les personnes qui exerçaient une activité lucrative.
Premières branches des assurances sociales, l’assurance militaire et l’assurance-accidents (fondées respectivement en 1902 et en 1918), versaient des rentes à leurs assurés et assurées invalides et prenaient en charge des mesures de rééducation visant à restaurer leur capacité de gain. Plus tard, les caisses de pension (en premier lieu les caisses de la fonction publique, suivies par les caisses d’entreprises) commencèrent elles aussi à verser des rentes d’invalidité, mais la couverture restait ponctuelle et partielle. En effet, seules les personnes actives affiliées à une assurance avaient droit aux prestations, ainsi que les soldats sous les drapeaux, couverts par l’assurance militaire. De surcroît, l’assurance-accidents ne prenait à sa charge que les accidents de travail et les maladies professionnelles reconnues et le nombre de personnes assurées restait lui aussi limité : jusque dans les années 1980, seule une personne salariée sur deux était obligatoirement assurée auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accident (Suva). Le nombre de salariés et salariées assurés en privé allait toutefois augmenter au fil du temps. La priorité accordée à la couverture de la perte de gain eut pour conséquence d’exclure de l’assurance les femmes, les enfants et les personnes âgées n’exerçant pas d’activité lucrative. En d’autres termes, une partie importante des personnes handicapées continuait à dépendre de l’aide sociale, en particulier celles présentant des infirmités congénitales, qui n’avaient jamais pu exercer d’activité lucrative.
C’est notamment pour combler ces lacunes que l’assurance-invalidité (AI) a été mise en place en 1960, après une gestation laborieuse (Organisations d'entraide de personnes handicapées). L’AI reprend la notion de l’invalidité telle que le conçoit le droit des assurances. Le montant de la rente est ainsi fonction de la durée de l’activité lucrative et des cotisations acquittées. Conçue, à l’instar de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), comme une assurance populaire, l’AI couvrait aussi dès sa fondation les personnes atteintes d’une infirmité congénitale, qui n’ont jamais versé de cotisations. Ces dernières ont également droit à une rente minimale et, ultérieurement, aux prestations complémentaires et à l’allocation pour impotent, au même titre que les bénéficiaires de rentes AVS. De surcroît, l’AI n’établit pas de distinction en fonction de la nature du handicap – une première européenne en 1960 –, de sorte que les handicapés mentaux sont eux aussi assurés. Au début, l’AI ne versait que des rentes entières et des demi-rentes, en fonction du degré d’invalidité : la personne assurée avait droit à une rente entière à partir d’un degré d’invalidité de 66,66 % et à une demi-rente à partir de 50 %. En 1986, l’AI a introduit des quarts de rente pour les personnes dont le degré d’invalidité était estimé entre 40 et 50 %. L’assurance prend aussi en charge des mesures de rééducation et de réadaptation professionnelle, finance des moyens auxiliaires – accessoires pour faciliter la marche ou appareils auditifs, par ex. – et verse des subventions aux écoles spécialisées et aux institutions, une tâche qui revient entièrement aux cantons depuis l’entrée en vigueur en 2011 de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Dès son origine, l’AI a adopté le principe qui veut que « la réadaptation prime la rente ». Ainsi, seule a droit à une rente la personne de laquelle on ne peut pas raisonnablement exiger l’exercice d’une activité lucrative, en dépit des mesures de réadaptation appliquées. Puisque les personnes présentant un (léger) handicap continuent en grande partie à travailler, le nombre de rentes AI est resté relativement modeste. En 2011, on estimait à 600 000 les personnes handicapées en âge de travailler en Suisse, alors que l’AI servait 238 000 rentes la même année. Le principe de la réadaptation veut que toute personne qui dépose une demande de prestations à l’AI doive en premier lieu se prêter à une mesure d’ordre médical ou professionnel, qui peut prendre la forme d’un traitement, d’un reclassement ou d’un placement. Dès sa création, l’AI a obligé les personnes assurées à participer à ces mesures, faute de quoi les prestations peuvent être supprimées ou refusées.
En raison du fléchissement conjoncturel, de la rationalisation de la production et de l’élargissement des définitions médicales de la maladie, le nombre de nouvelles rentes a explosé à la fin des années 1990. A la même époque, des partis politiques ont commencé à mettre la question des abus sur le tapis. Depuis 1990, des voix de plus en plus fortes se sont aussi élevées pour demander que les personnes aux capacités réduites – et notamment les malades psychiques – soient davantage intégrées au marché du travail. Pour cette raison, la 5e révision de l’AI (2008) a adopté des mesures de détection et d’intervention précoces, qui, du point de vue de l’assurance, ont estompé les limites entre valides et invalides. Les pouvoirs publics ont également renforcé la collaboration entre l’AI, l'assurance chômage et l’aide sociale. Pour les bénéficiaires de prestations, ces nouveautés n’ont pas comporté que des avantages, d’autant plus que d’autres mesures d’austérité – comme la révision des anciennes rentes – restent à l’ordre du jour. Si l’AI a redoublé d’efforts en matière de réadaptation, elle a aussi exercé davantage de pression sur des personnes dont la capacité de travail est réduite pour des raisons de santé, afin qu’elles se plient aux contraintes d’une société axée sur le travail, qui fait souvent peu de cas de leurs besoins.
De nouvelles approches : égalité et intégration
La discrimination est souvent le corollaire du handicap, un constat qui vaut aussi pour la politique sociale. Même l’AI est longtemps restée le pré carré de fonctionnaires, de juristes, de médecins et d’actuaires, où l’avis des personnes intéressées ne comptait guère. Dans le sillage de Mai 68, une jeune génération de personnes handicapées engagées sur le plan politique a cependant remis toujours davantage en question le pouvoir de définition des autorités et des experts. Ainsi, la revue Puls a abordé des sujets tels que l’accessibilité des bâtiments et des logements, la sexualité et les rapports entre les personnes handicapées et les autres membres de la société, autant de thèmes pratiquement absents du débat politique jusque lors. Les activités que les pouvoirs publics suisses ont organisées à l’occasion de l’Année internationale des personnes handicapées en 1981 ont aussi fait l’objet d’une analyse critique.
La cause de l’égalité est alors devenue le moteur d’un nouveau mouvement dans lequel les différents groupes de personnes handicapées se sont engagés à des degrés divers. Les militants voyaient dans le handicap une conséquence de la discrimination. Dans cette lecture, il incombait à la société de s’adapter aux besoins particuliers des porteurs de handicap, et non l’inverse. Les domaines des transports, de la formation et de l’autonomie dans le logement étaient jugés particulièrement cruciaux. En 1998, peu de temps après le rejet de la 4e révision de l’AI (une première tentative d’en diminuer les prestations), les associations de personnes handicapées lançaient une initiative populaire demandant l’inscription dans la Constitution fédérale d’une interdiction générale de discriminer. Celle-ci a toutefois échoué cinq ans plus tard devant le peuple et les cantons. Dans l’intervalle, le Parlement avait adopté, en tant que contre-projet indirect, la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Cet acte législatif, qui régit en particulier l’accès aux bâtiments publics, aux transports en commun et aux services de l’administration, applique une définition du handicap bien plus large que la notion d’invalidité des assurances sociales. Pour la LHand, le handicap se mesure à la capacité d’accomplir les actes de la vie quotidienne, de nouer des contacts sociaux, de se déplacer et de se former.
Le principe d’égalité met en avant la promotion de l’intégration et de l’autonomie. Ainsi, la LHand contraint les cantons à favoriser l’école intégrative au détriment de l’enseignement spécialisé. Dans la mesure du possible, les enfants en situation de handicap doivent pouvoir être scolarisés dans une classe ordinaire. La mise en œuvre de cette disposition s’est toutefois avérée plus difficile qu’escompté. Ainsi, la question de l’autonomie s’est à nouveau posée dans le cadre du projet de révision partielle de la LHand élaboré en 2023. En effet, certains organismes ont critiqué le fait que le projet ne prévoie pas d’améliorer l’accessibilité des transports publics.
Par ailleurs, l’autonomie des personnes en situation de handicap a également été renforcée dans l’assurance-invalidité. La 6e révision de l’AI (1er volet) a ainsi introduit la contribution d’assistance, après plusieurs projets pilotes : les personnes ayant droit à une allocation pour impotent qui vivent chez elles peuvent désormais engager des tiers aux frais de l’AI pour recevoir l’aide nécessaire. Elles peuvent ainsi organiser elles-mêmes leur prise en charge, en fonction de leurs besoins, de sorte qu’elles ne sont plus obligées de vivre en institution. L’accent mis sur l’autonomie – et sur la responsabilité individuelle – se reflète dans la modification des flux financiers : en lieu et place d’aller de l’assurance aux institutions, les paiements sont directement effectués sur le compte des assurés.
Le Développement continu de l’AI (DC AI) est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Cette révision de loi vise à encore renforcer la réadaptation professionnelle et à prévenir l’invalidité. Le changement le plus important concerne le calcul de la rente, l’ancien système par paliers ayant été remplacé par un système linéaire. Ainsi, le droit à la rente est désormais déterminé au pour-cent près sur la base du taux d’invalidité, qui dépend quant à lui fortement du résultat de l’expertise médicale. Dans ce domaine, le DC AI a introduit des mesures visant à améliorer la transparence et la qualité des expertises. Dans le nouveau système, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière. À partir d’un taux d’invalidité de 70 %, l’assuré a droit à une rente entière ; un taux inférieur donne droit à une rente partielle exprimée en pourcentage. Comme dans l’ancien système, un taux d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Germann Urs (2010), Integration durch Arbeit. Behindertenpolitik und die Entwicklung des schweizerischen Sozialstaats 1900–1960, in : E. Bösl et al. (éd.), Disability History. Konstruktionen von Behinderung in der Geschichte, Bielefeld, 151–168 ; Kaba Mariama (2007), Des reproches d’inutilité au spectre de l’abus. Etude diachronique des conceptions du handicap du XIXe siècle à nos jours, in : Carnets de bord, 13, 68–77 ; Wolfisberg Carlo (2002), Heilpädagogik und Eugenik. Zur Geschichte der Heilpädagogik in der deutschsprachigen Schweiz, Zurich ; Graf Otto Maria (éd.), PULS – DruckSACHE aus der Behindertenbewegung. Materialien für die Wiederaneignung einer Geschichte, Zurich. Canonica Alan (2012), Missbrauch und Reform. Dimensionen und Funktionen der Missbrauchsdebatten in der schweizerischen Invalidenversicherung aus historischer Perspektive, in: Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 13, 2012, pp. 24-37. Canonica Alan (2020), Beeinträchtigte Arbeitskraft. Konventionen der beruflichen Eingliederung zwischen Invalidenversicherung und Arbeitgeber (1945-–2008), Zurigo. Nadai Eva, Canonica Alan, Gonon Anna, Rotzetter Fabienne, Lengwiler Martin (2019), Werten und Verwerten. Konventionen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Wirtschaft und Wohlfahrtstaat, Wiesbaden. Gonon Anna, Rotzetter Fabienne (2017), Zückerchen für Arbeitgebende. Sozialstaatliche Anreize zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen in der Schweiz, in: Soziale Passagen 9, pp. 153-168. HLS / DHS / DSS: Handicapés.
(07/2024)